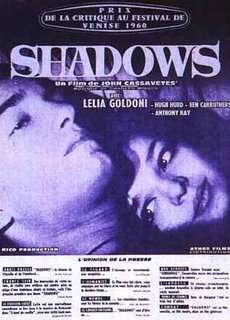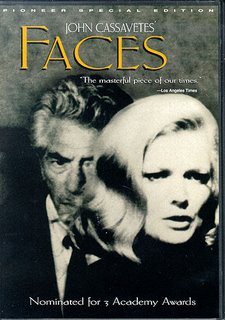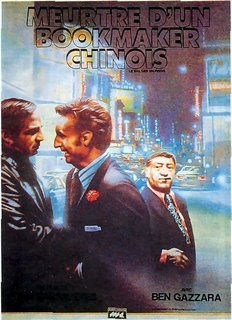Titre Français :
M le MauditTitre Original :
M Eine Stadt Sucht Einen Mörder1931 - Allemagne
Policier / Film-noir / Thriller - 1h45
Réalisation :
Fritz Lang Avec :
Peter Lorre (Hans Beckert),
Gustaf Gründgens (Schraenker),
Ellen Widmann (Madaem Beckmann),
Inge Landgut (Elsie Beckmann),
Otto Wernicke (Inspecteur Karl Lohmann)...
Scénario :
Fritz Lang et
Thea von Harbou, d'après un article d'
Egon Jakobson Photographie : Fritz Arno Wagner
Décors : Edgar G. Ulmer
Production : Nero Films
Fritz Lang parle de "M le Maudit"
Dans un entretien aux « Cahiers du cinéma » publié en 1966, le réalisateur explique qu'il a fait appel à « douze ou quatorze hors-la-loi » pour tourner la scène du jugement
Après les grandes fresques des Nibelungen, Metropolis et La Femme sur la lune, je me suis intéressé davantage aux êtres humains, aux mobiles de leurs actes. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, M le Maudit n'était pas tiré de la vie de l'infâme assassin de Düsseldorf, Peter Kürt. Il se trouve qu'il avait juste commencé sa série de meurtres pendant que Thea von Harbou et moi étions en train d'écrire le scénario. Le script était terminé bien avant qu'il ne soit pris.
En fait, la première idée du sujet du film M m'est venue en lisant un article dans les journaux. Je lis toujours un peu les journaux en quête d'un point de départ pour une histoire. A cette époque, je travaillais avec la Scotland Yard de Berlin (à Alexanderplatz), et j'avais accès à certains dossiers dont la teneur était assez confidentielle. C'étaient des rapports sur d'innombrables assassins comme Grossman de Berlin, le terrible Ogre de Hanovre (qui a tué tant de jeunes gens) et d'autres criminels de même acabit.
Pour le jugement, dans M, je reçus l'aide inattendue d'une organisation de malfaiteurs parmi lesquels je m'étais fait des amis au début de mes recherches pour le film. En fait, j'ai vraiment utilisé douze ou quatorze de ces hors-la-loi, qui n'étaient pas effrayés à l'idée d'apparaître devant ma caméra car ils avaient déjà été photographiés par la police.
 MON PREMIER FILM PARLANT
MON PREMIER FILM PARLANT
D'autres auraient bien aimé m'aider, mais ils n'ont pas pu le faire, parce qu'ils n'étaient pas connus des brigades criminelles. J'étais en train de finir le tournage des scènes où se trouvaient donc de véritables malfaiteurs, quand j'ai été informé que la police arrivait. Je l'ai dit à mes amis, mais en les priant de rester pour les deux dernières scènes. Ils acceptèrent tous et j'ai tourné très rapidement. Quand la police arriva, mes scènes étaient dans la boîte et mes « acteurs » avaient tous disparu
Si j'avais été associé à un producteur, je n'aurais jamais pu faire ce film. Quel producteur aurait voulu d'un film sans histoire d'amour et où le héros est un assassin d'enfants ? Comme M était mon premier film parlant, j'ai fait des expériences avec le son, qui n'étaient évidemment pas possibles dans le cinéma muet.
Souvenez-vous du mendiant aveugle qui va au Bazar des mendiants pour louer un orgue à main : quand on lui joue un morceau, quelques fausses notes heurtent son ouïe ; brusquement, il met ses mains sur ses oreilles pour ne plus entendre ces sons discordants et, au même moment, la musique s'arrête dans le film. Il y a d'autres moments où je me suis servi du son : les pas dans le silence étrange d'une rue, la nuit, ou bien la respiration lourde du tueur d'enfants.
Mais, de même que le son peut donner de l'intensité à une scène, la suppression délibérée d'une action peut en augmenter le contenu dramatique. Laissez-moi vous expliquer... Quand l'enfant est tuée, sa petite balle sort en roulant d'un buisson et finalement s'arrête. Le public l'a identifiée avec la petite fille et à partir de cela, par association d'idées, il sait qu'avec le mouvement de la balle, la vie de la petite fille s'est arrêtée aussi.
Je ne pouvais pas, bien sûr, montrer d'horribles violences sexuelles sur cette enfant, mais en ne montrant pas l'action, j'obtenais plus de réactions chez le public que si j'avais réellement montré la scène en détail. J'obligeais le spectateur à se servir de sa propre imagination.
UNE SORTE DE PSYCHANALYSTE
 D'autre part, un simple procédé peut augmenter l'intensité d'une scène en montrant ce que l'acteur est supposé penser. Vous souvenez-vous du « gadget » mobile dans la vitrine d'une boutique de jouets ? Une flèche se déplaçant de haut en bas vers l'oeil d'un taureau ?... Cela prend pour le meurtrier une signification sexuelle dont le public est pleinement conscient... [...]
D'autre part, un simple procédé peut augmenter l'intensité d'une scène en montrant ce que l'acteur est supposé penser. Vous souvenez-vous du « gadget » mobile dans la vitrine d'une boutique de jouets ? Une flèche se déplaçant de haut en bas vers l'oeil d'un taureau ?... Cela prend pour le meurtrier une signification sexuelle dont le public est pleinement conscient... [...]
J'ai souvent dit qu'un metteur en scène, travaillant avec des acteurs, devait être une sorte de psychanalyste, non pas pour les acteurs eux-mêmes, bien sûr, mais pour les personnages. Ils existent d'abord sur le papier ; le metteur en scène doit les faire vivre pour l'acteur, puis pour le public.
Un jour, à Hollywood, un écrivain m'a dit : « Je sais exactement ce que vous pensiez quand vous tourniez telle scène de M », et je lui ai répondu : « Dites-le. » Il m'a longuement débité sa théorie et c'était complètement faux. Du moins, je le pensais à l'époque, mais des années plus tard, alors que j'étais en pleine conférence de presse à Paris et que je racontais cette anecdote, je me suis arrêté net, parce que j'ai réalisé qu'il pouvait y avoir une profonde vérité dans ce genre de choses... que ce que l'on appelle la « touche » d'un metteur en scène venait de son subconscient - et lui-même en est inconscient quand il fait son film...
Gretchen Weinberg
Une confession de Fritz Lang "Cahiers du cinéma" publié en Juin 1966
L'Auteur en Majesté
 Comme Griffith , Murnau et quelques autres, Fritz Lang fait partie de la petite communauté de cinéastes qui, d'emblée, malgré une méfiance originelle envers un art jugé impur, ont été considérés comme des artistes majeurs. A tel point que le créateur de Metropolis, en 1927, en est venu à incarner l'Auteur dans toute sa majesté (et à jouer ce rôle dans Le Mépris réalisé par Jean-Luc Godard en 1963).
Comme Griffith , Murnau et quelques autres, Fritz Lang fait partie de la petite communauté de cinéastes qui, d'emblée, malgré une méfiance originelle envers un art jugé impur, ont été considérés comme des artistes majeurs. A tel point que le créateur de Metropolis, en 1927, en est venu à incarner l'Auteur dans toute sa majesté (et à jouer ce rôle dans Le Mépris réalisé par Jean-Luc Godard en 1963).
Pendant sa carrière européenne, de 1919 avec Le Maître de l'amour à 1934 avec Liliom, Lang exerce un contrôle absolu sur la fabrication de ses films. A Hollywood (de Furie en 1936 au Diabolique Docteur Mabuse en 1960), il luttera pour conserver sa liberté.
Il avait tout du mythe : l'oeuvre géniale, où se succèdent les chefs-d'oeuvre, et une incroyable personnalité.
Prenons par exemple l'histoire de sa convocation par Goebbels. Il venait de réaliser un film ouvertement antinazi, Le Testament du Docteur Mabuse en 1932. Mais voici que le ministre de la propagande lui déclare : « Le Führer a vu votre film Metropolis et a dit : voici l'homme qui créera le cinéma national-socialiste. » « Le soir même, j'étais dans le train », racontait Lang. L'anecdote manque de sérieux historique ? Qu'importe, elle est plus langienne que nature avec son mélange d'angoisse et de panache.
 Fritz Lang était né à Vienne, en 1890, dans la bonne bourgeoisie catholique (sa mère, juive, s'était convertie). Tenté par la peinture, il se découvre, à Berlin, une vocation de cinéaste. Décision qui naquit, écrivit-il, « d'une conviction étrange, presque somnambulique ».
Fritz Lang était né à Vienne, en 1890, dans la bonne bourgeoisie catholique (sa mère, juive, s'était convertie). Tenté par la peinture, il se découvre, à Berlin, une vocation de cinéaste. Décision qui naquit, écrivit-il, « d'une conviction étrange, presque somnambulique ».
Sa première femme se suicide après l'avoir découvert dans les bras de sa scénariste, Théa von Harbou. Lang est soupçonné de meurtre, expérience qui le laisse paranoïaque : son amie et biographe Lotte Eisner raconte que, jusqu'à trente ans plus tard, établi à Beverly Hills, il notait tous ses faits et gestes dans un « épais volume » pour avoir toujours un alibi irréfutable à disposition.
Dans les films allemands, son style est déjà d'une audace étonnante. Surimpressions admirables dans Docteur Mabuse en 1922 ; géométrie précise dans Les Nibelungen en 1924 et le futuriste Metropolis en 1926.
Les ombres qui planent sur M le Maudit annoncent l'avenir immédiat de l'Allemagne. Plus largement, elles témoignent d'une conception de l'homme fondée sur la pulsion de mort. « Le désir de blesser, le désir de tuer, écrivait-il, sont étroitement liés au besoin sexuel, sous l'empire duquel aucun homme n'agit raisonnablement. »
La mort, « le plus grand drame », qui « a toujours le dernier mot », hante toute son oeuvre, des sublimes films noirs (La Femme au portrait en 1944 ; Le Secret derrière la porte en 1948) au chef-d'oeuvre sur l'enfance déguisé en film d'aventures (Les Contrebandiers de Moonfleet en 1955).
Il s'éteint en 1976, seize ans après un dernier Mabuse, laissant une oeuvre immense. « Lang, qui vivait avec tant d'intensité, ne se laisse pas réduire - lui et ses films - à un dénominateur commun », écrivait Lotte Eisner.
Florence Colombani
Article Le Monde dans l'édition du 03.10.2004
 M ou l'Esprit de la Lettre
M ou l'Esprit de la Lettre
C'est à la lettre, évidemment, qu'il faut prendre le plan le plus connu de M le Maudit. Etonnante cinégénie de ce caractère central de l'alphabet qui s'inscrit au milieu de l'écran au moment où le tueur de fillettes découvre dans un miroir la marque infamante qui le désigne à la vindicte publique. Il n'est guère moyen, en effet, de différencier le M majuscule de son reflet.
La lettre et son double viennent illustrer un principe de réversibilité dont l'affirmation, répétée tout au long du film, continue à fasciner et à déranger le spectateur du XXIe siècle. Aplanissement de tous les pôles, perte des points de repère : le premier opus parlant de Fritz Lang fait partie de ces rares chefs-d'oeuvre dont la consécration ne réussira jamais à éroder le pouvoir subversif.
Lorsque tant d'autres films jouent de la transformation, M proclame, comme son héros psychopathe, que je est aussi un autre. Manière d'affirmer, en radicalisant le modèle romanesque de Stevenson (que Lang ne fera qu'adapter tout au long de sa carrière), que Dr Jekyll est Mr Hyde. Il faut donc revenir au personnage de Hans Beckert, créature hallucinée interprétée par un Peter Lorre extatique, et l'entendre déclarer à ses juges en une séance fulgurante d'auto-analyse : « Je sens que quelqu'un me suit par les rues. C'est l'autre qui me poursuit. Et parfois j'ai l'impression de me poursuivre moi-même. »
Dès lors, la culpabilité du tueur d'enfants n'a plus d'égale que son insupportable irresponsabilité. Sa question toute rhétorique « Est-ce que je peux faire autrement ? » renvoie à l'idée d'une malédiction à l'antique que la traduction française du titre, pourtant excessivement bavarde, perçoit avec justesse. La force de Lang est précisément de ne pas escamoter le scandale et le trouble que suscite ce point de vue. Le cinéaste donne donc la parole aux tenants de la plus radicale des politiques répressives et les laisse ironiser sur l'innocence d'un criminel qu'ils ont condamné bien avant la mascarade du procès.
 TRIBUNAL DE GUEUX ET DE CRIMINELS
TRIBUNAL DE GUEUX ET DE CRIMINELS
« Elle est bonne ! Pour qu'on te déclare irresponsable et qu'on te cajole dans une maison de santé ! Puis tu t'échapperas ou il y aura une amnistie. Et toi, peinard, t'as rien à craindre : t'es irresponsable. Tu zigouilleras encore des fillettes ! » Discours universellement connu que celui des tenants de la peine de mort, avec lequel le cinéaste prend ses distances. C'est un tribunal de gueux et de criminels - présidé par un chef de gang dont la blondeur, le manteau de cuir et la froide brutalité dessinent avant l'heure le nazi archétypal - dont les résolutions eugénistes invitent à l'exécution : « Il faut l'exterminer. Il faut l'éliminer. » Termes terrifiants au regard de l'Histoire.
Gardons-nous pourtant de conclure à la supériorité de la justice régulière sur celle de la pègre. Le procès souterrain n'est sans doute que la métaphore du procès régulier. L'issue de ce dernier, dont Lang feint de se désintéresser, ne sera probablement pas différente pour l'accusé. Les citoyens ordinaires n'ont-ils pas fait montre dès les premières minutes du film d'un goût pour le lynchage que ne renie pas la faune de l'Unterwelt ?
 Comment, d'ailleurs, ne pas interpréter dans le même sens la quête parallèle des hors-la-loi et des policiers ? Et le comble que représente la victoire de bandits bien organisés prenant de vitesse les autorités dans leur traque du criminel ? Le commissaire ment à celui qu'il veut faire avouer. Le cambrioleur pris sur le fait se compare à un « nouveau-né ». L'assassin est formellement reconnu par un aveugle. C'est bien un monde où se répondent vrais coupables et faux innocents qui se dessine.
Comment, d'ailleurs, ne pas interpréter dans le même sens la quête parallèle des hors-la-loi et des policiers ? Et le comble que représente la victoire de bandits bien organisés prenant de vitesse les autorités dans leur traque du criminel ? Le commissaire ment à celui qu'il veut faire avouer. Le cambrioleur pris sur le fait se compare à un « nouveau-né ». L'assassin est formellement reconnu par un aveugle. C'est bien un monde où se répondent vrais coupables et faux innocents qui se dessine.
La puissance démonstrative du raccord sonore enfonce le clou : une phrase commencée par un policier peut être terminée par un truand. Le genre même du film est contaminé par cette confusion généralisée. La multiplication des documents écrits - journaux, affiches, lettres - ainsi que la description minutieuse des indices et des méthodes d'investigation des enquêteurs abolissent la frontière du documentaire et de la fiction. Ne subsiste alors que le doute hyperbolique et violemment pessimiste d'un cinéaste qui n'hésite pas à s'impliquer dans le scepticisme ambiant. Nul n'a oublié l'obsédante Chanson de Solveig, tirée de Peer Gynt, de Grieg, qui sert de leitmotiv aux apparitions du criminel. Devant l'incapacité de Peter Lorre à siffloter la fameuse scie, Fritz Lang choisit, dit-on, d'interpréter lui-même l'entêtante mélodie du tueur. Et de devenir, à jamais, la doublure de M.
Thierry Méranger - Le Monde
Extrait : M le Maudit (1931) Fritz Lang

 Etudiant, il est repéré par Roger Corman, producteur de séries B et grand découvreur de talents. Corman finance son premier long-métrage, Dementia 13, un film noir où l'on note un goût certain pour la tragédie familiale. Coppola travaille aussi comme scénariste, une activité qui lui vaudra son premier Oscar. Il tourne pour Warner Big Boy (1967), un émouvant récit d'apprentissage, puis se retrouve prisonnier du système des studios, aux commandes de La Vallée du bonheur (1968), une comédie musicale avec Fred Astaire. Son film suivant, Les Gens de la pluie, portrait d'une épouse insatisfaite qui plaque tout, est un road-movie saisissant.
Etudiant, il est repéré par Roger Corman, producteur de séries B et grand découvreur de talents. Corman finance son premier long-métrage, Dementia 13, un film noir où l'on note un goût certain pour la tragédie familiale. Coppola travaille aussi comme scénariste, une activité qui lui vaudra son premier Oscar. Il tourne pour Warner Big Boy (1967), un émouvant récit d'apprentissage, puis se retrouve prisonnier du système des studios, aux commandes de La Vallée du bonheur (1968), une comédie musicale avec Fred Astaire. Son film suivant, Les Gens de la pluie, portrait d'une épouse insatisfaite qui plaque tout, est un road-movie saisissant. Gangster en quête d'idéal
Gangster en quête d'idéal